Découvrez les 7 sites classés patrimoine universelle en Algérie.
Algérie : 7 sites classés patrimoine universel de l’Humanité .
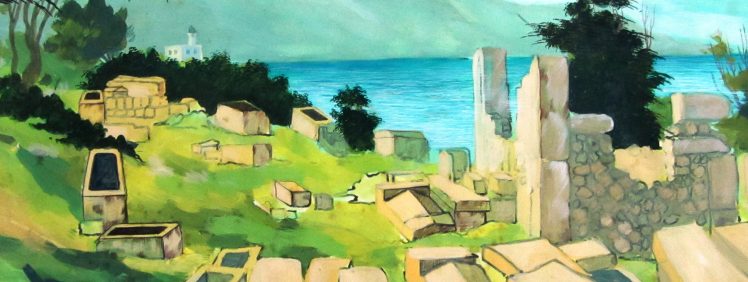
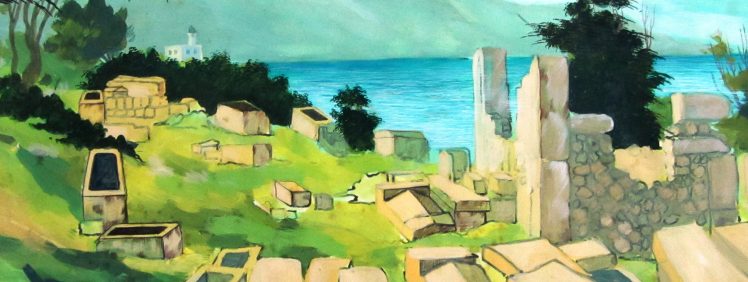
Découvrez les 7 sites classés patrimoine universelle en Algérie.
Aux éditions Al-Bayazin, ce sont le caricaturiste Hichem Baba Ahmed, alias Le Hic, le consultant et photographe Ahmed Aït Issad, l’animatrice de radio Amel Feddi et le jeune guide Yacine Boushaki qui ont livré leurs regards “entrecroisés” sur Alger.
La 5e Nuit des idées, événement culturel annuel organisé par l’Institut français dans plus de quatre-vingt-dix pays dont l’Algérie, s’est tenue simultanément avant-hier soir à Blida, à Alger, à Annaba et à Constantine. Vingt lieux et vingt partenaires ont ainsi ouvert leurs portes à des intervenants de tous bords, écrivains, plasticiens, cinéastes, musiciens et chercheurs, pour débattre, de 17h à 2h du matin, autour du thème “Être vivant”.
Parce que la place de l’homme est aussi liée à la planète, le thème de cette année questionne également sur les “équilibres écologiques et de la relation de l’homme au monde”. Aux éditions El-Bayazin, ce sont le caricaturiste Hichem Baba Ahmed, alias Le Hic, le consultant et photographe Ahmed Aït Issad, l’animatrice de radio Amel Feddi et le jeune guide Yacine Boushaki qui ont livré leurs regards “entrecroisés” sur la capitale algéroise.
Qu’elle soit “Vue d’en bas”, à travers les hommes et les femmes qui lui donnent toute son âme, sa musique, sa jeunesse, aussi créative que rebelle, son urbanité, et même l’image parfois trop glorifiante qu’on peut lui prêter, la capitale a été, pour ainsi dire, explorée, disséquée par des points de vue diamétralement opposés.
Pour Amel Feddi, animatrice à la Chaîne III, dont la carrière a débuté à la rubrique sportive, c’est au contact de musiciens de toute l’Algérie qu’elle rencontre dans le cadre de son émission “Diwane”, lancée en 2007, qu’elle découvre des trésors cachés d’oralité.
Transmis de génération en génération, notre patrimoine oral se réinvente sous de nouvelles formes, grâce à une jeunesse qui a su en faire un moyen de contestation. “Je prends l’exemple de Ouled El-Bahdja et la Casa d’El Mouradia”, a expliqué Amel Feddi. “L’oralité est là finalement, les jeunes aujourd’hui, quand ils s’apprêtent à écrire des chansons, puisent dans cette culture populaire qui deviendra elle aussi une tradition orale.”
Et de poursuivre : “Alger est une ville qui foisonne ; depuis quelques mois, elle voit ses artistes crier via et grâce au Hirak, des jeunes viennent chanter, partager et proposer des idées pour le futur.” Le consultant et photographe Ahmed Aït Issad et Le Hic ont, pour leur part, livré des points de vue opposés sur la capitale.
De par son travail sur le terrain, intitulé “L’Algérie vue d’en bas”, Aït Issad veut démystifier l’image d’Alger qui reste “joyeuse, multiculturelle et authentiquement moderne”. Ses artistes de rue, par exemple Moh Vita et tant d’autres, sont l’âme même de la ville.
Le Hic, en revanche, a estimé que l’amour qu’il porte à Alger “est forcé”. “J’essaye de lui trouver du charme, mais je ne trouve pas du tout qu’elle est vivante. Si je me mets dans la peau du caricaturiste que je suis pour parler d’elle, je dirai qu’on nous reproche, nous qui travaillons dans les médias en général, de parler uniquement d’Alger. Donc, on a toujours ce réflexe d’essayer de se détacher d’Alger.”
Et au caricaturiste de “démystifier” l’image qu’on a d’Alger, de sa baie, de sa Casbah, car, dit-il, “Alger ne se limite pas à La Casbah, c’est aussi l’intérieur et des villes comme Dely Ibrahim, El-Harrach, Chéraga, etc.”. Et même si elle est autant représentée dans ses caricatures, c’est “afin de situer le lieu, à travers quelques iconographies d’Alger, mais tout cela reste caricatural”.
Source : Yasmine Azzouz “Quotidien Liberté”
Welcome to TokoPress Demo Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Qassaman en Sardaigne ! Le 18 juin 2000, c’est l’habituel Tournoi d’Alghero en Sardaigne, notre athlète emblématique arrive en demi-finale d’une compétition. Elle voit arriver vers elle l’une des organisatrices, affolée, qui vient lui dire que l’hymne algérien et le drapeau ne sont pas disponibles. Autant amusée qu’irritée Salima Souakri sait que les algériens n’ont jamais brillé lors de ce tournoi. Et les organisateurs italiens trop sûrs d’eux-mêmes n’ont jamais prévu une victoire algérienne, d’où l’absence de drapeau et d’hymne algérien. Et voilà qu’une jeune sportive nommée Salima vient leur damer le pion. Elle avait pourtant averti les organisateurs par un...